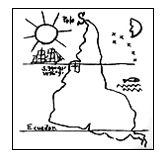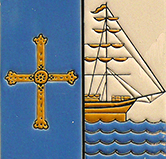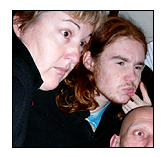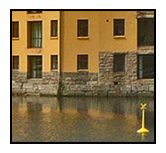Deux soirs par semaine, quelques fêlés de tambour se rassemblent à un carrefour de la petite ville. Ça commence avec un feu, que les trois premiers arrivés allument au pied des arbres ou des palmiers, un feu au bord du trottoir. Le feu est alimenté par des saisies sur les broussailles du quartier ou la récupération d'un tas de caisses en bois confiées aux cartoneros (1). Parfois par un prélèvement sur une palissade voisine ou même le tas de bois de chauffe d'un habitant proche. Un feu qui chauffera les peaux des tambours assemblés en cercle. Un feu qui réchauffera les corps gelés des joueurs ou des spectateurs, quand le vent froid du sud soufflera. Ça commence avec trois tambours au moins. S'il n'y a pas trois tambours, on ne peut pas jouer le candombé. Le chico, petit tambour au fût tout mince, le repique, un peu plus large au son un peu moins sec et le piano, le gros costaud qui sonne si profond. Chacun son rôle, chacun ses partitions.
La soirée commence comme un bricolage musical. L'un ou l'autre joueur fait sonner son tambour pour tester la tension de la peau. Si un autre embraye avec sa propre partition il se peut qu'un troisième vienne compléter l'harmonie, lançant alors une séquence qui peut durer plusieurs minutes. Pendant ces premiers bricolages, les tambours sont posés sur le sol voire couchés dos au feu pour que l'air chaud entre par le bas et chauffe la peau de l'intérieur. Chaque joueur est agenouillé à coté de son engin ou penché vers lui dans la position qu'on prend pour un simple test du bout de la baguette et si la musique démarre, ils restent comme coincés dans cette première position, parfois inconfortable, pendant toute la séquence. Et puis on laisse le feu travailler les peaux en bavardant et en échangeant des nouvelles et ragots. Un pack de vin rouge et quelques joints circulent entre les joueurs et le public. Le son des premières séquences d'accordage s'est propagé aux quartiers voisins ce qui fait que d'autres fêlés surgissent dans la lumière du feu, un fût de bois cerclé de métal en bandoulière, venant grossir le groupe, posant leur instrument dans le cercle avec les autres et attrapant le litre de rouge au passage. Ils sont maintenant plus nombreux, plusieurs de chacun des trois tambours (2).
Et puis, sur le signal de l'un d'entre eux, chaque joueur soulève son tambour et passe la sangle sur une épaule. Ils vont jouer vraiment et non plus en séquences semi-improvisées. Ils vont jouer plus fort, plus intensément, plus longuement. Si le mix des trois tambours est équilibré, il sera plus facile pour eux de faire pulser les sons, de faire monter la transe. La transe des joueurs et la transe des danseurs. Chaque rassemblement est différent, certains sont riches et créatifs, d'autres plus laborieux. Certains sont expérimentaux, les joueurs échangeant leurs rôles pour s'entrainer à jouer l'autre partition, d'autres plus passionnés, quand les harmoniques se parlent et que le dialogue entre les mains qui frappent et les corps qui dansent s'installe. Souvent, ils se mettent en mouvement, ils marchent, à tous petits pas, proches du piétinement, en mémoire des chaines. Les chaines entre les fers aux pieds que portaient les esclaves et qui limitaient leurs mouvements. Car cette musique faite exclusivement de tambours vient des esclaves noirs, ça semble évident dès la première écoute, bien que les joueurs d'aujourd'hui soient majoritairement de peau claire (3).
Les chico donnent la cadence du pas et de la musique, ils ont la lourde tâche de rester inlassablement et imperturbablement sur un mouvement simple composé d'une frappe de la main gauche directement sur la peau et de deux ou trois frappes à la baguette de la main droite. Rien d'autre. C'est l'ossature sur laquelle s'appuient les autres tambours. Le premier temps de chaque mesure est le silence qui précède la première frappe du chico. Détail crucial que Gustavo a tenté de m'enseigner et qui donne son accent typique à toute la musique. Les repique et les piano brodent des motifs bien plus complexes, syncopés, évoluant de minute en minute en intensité et en rythme, avec des accélérations et des ralentissements. De temps en temps, un appel est lancé, une frappe particulière sur le bois du tambour, auxquels ils répondent presque tous par le même son, suivi d'un changement de rythmique.
La première soirée à laquelle nous avons participé a été pour moi comme une revanche sur l'Afrique, où nous n'avions pas eu beaucoup d'occasions de jouer ni d'entendre de près les Djembés traditionnels. Je me suis laissée emporter par ces rythmes dans des gestes, pas et postures de danse africaine, le dos droit et les mouvements vifs, pour ne découvrir que plus tard que le Candombé se danse avec des ondulations des hanches et des bras qui ne ressemblent à rien de ce que je connaissais avant. Qu'ont compris les joueurs de mes gesticulations étranges sur leur musique ? Je l'ignore, mais ils ont semble-t-il apprécié l'énergie que j'y ai mise, l'écho gestuel que je leur ai renvoyé de leur musique. Ariel de son côté a frappé deux bouts de bois parfaitement dans le rythme. Ce qui fait qu'on a été adoptés rapidement par la bande et qu'on a pris l'habitude d'y aller avec régularité. Les joueurs, on les retrouve en journée dans la ville, l'un comme chauffeur de taxi quand il faut porter nos bouteilles de gaz à recharger, l'autre comme marin-pêcheur sur les quais du port. J'ai vu un jour un éboueur taper un rythme sur une poubelle et nous avons échangé un sourire quand il m'a vue le voir et reconnaitre ce qu'il faisait. C'est comme ça dans tout le pays ou presque. Des gens aux vies ordinaires se rassemblent le soir au bord d'un trottoir pour taper sur des peaux tendues au-dessus de futs en latte cerclées dont certaines sont d'anciennes barriques à yerba maté (4).
-
Le métier de cartonero est à la fois une bouée de sauvetage pour la grande pauvreté et une activité fort utile aux villes d'Amérique Latine. Les cartoneros circulent la nuit en charrette à bras ou à cheval et ramassent les déchets par catégorie (papiers et cartons, plastiques, bois, métaux) pour les diriger vers les circuits de revalorisation qui les achètent au poids.
-
Un grand groupe peut compter 25 à 30 tambours, j'en ai vu un de ce genre dans le quartier nommé Barrio Sur, à Montevideo. Quartier réputé pour son candombé du dimanche soir. Même les bus le savent, qui ne protestent pas contre l'arrêt obligé à cause de l'encombrement de tambours et de danseurs au milieu des rues.
-
Il nous semble étrange qu'un pays d'élevage comme l'Uruguay puisse entretenir des traditions venant des esclaves, comme s'il singeait le Brésil qui, lui, est un pays de canne à sucre et de mines, grand consommateurs d'esclaves aux temps des colonies, mais c'est ainsi. Les Uruguayens batteurs de tambours revendiquent un « nous » qui englobe des origines noires même si celui qui affirme ce « nous » n'a visiblement pas une once de sang noir dans les veines. « On sait bien que ce n'est pas génétique, cette origine noire, mais c'est identitaire tout de même pour les uruguayens. » nous a expliqué Gustavo, qui est en fait plus sûrement un descendant d'esclavagistes qu'un descendant d'esclaves puisque ses ancêtres sont portugais et espagnols. Rafael, quant à lui, nous a précisé que les esclaves débarqués des bateaux espagnols ne venaient pas des mêmes territoires africains que ceux apportés par les portugais, ce qui explique de les traditions issues des esclaves soient différentes au Brésil et en Uruguay. Certains historiens disent que l'origine du Candombé est Bantoue.
- Il y a même un festival annuel de Candombé, comme le festival de Samba de Rio de Janeiro, avec défilé des groupes précédés de danseurs et danseuses en costume devant un jury. C'est toute la pratique communautaire du Candombé qui a été classée en 2009 par l'UNESCO comme patrimoine culturel immatériel de l'humanité.