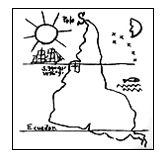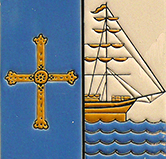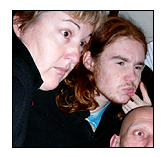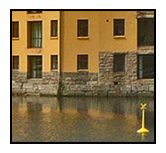Chaque fois que nous quittons l'abri d'une caleta c'est avec l'espoir de pouvoir naviguer à la voile et la crainte des mauvaises surprises que cette région du monde recèle. Durant ce premier mois de découverte, mois pendant lequel nous avons emprunté un petit détour vers les glaciers puis remonté le bras nord-ouest du détroit de Magellan, toutes nos navigations ont été exaltantes et toutes - sauf une - ont été marquées d'inquiétude. Le prix à payer pour tirer des bords dans les canaux du grand sud, c'est d'avoir en tête l'heure d'arrivée au prochain abri. La saveur d'une petite heure de vent portant dans le détroit, chose rarissime, est altérée par l'excès d'épice que constitue le mur de grains qui s'assemble dans notre dos. Alors on porte des voiles réduites, beaucoup plus réduites que d'habitude et on garde très souvent le moteur allumé, à petit régime. Pour mieux passer le clapot haché qui casse l'élan de notre coque petite et large (1). Pour améliorer le cap contre le vent. Pour virer de bord sans hésiter à la moindre opportunité, à la recherche de toutes les « adonnantes », légères rotations du vent qui facilitent notre progression sur un bord plutôt que sur l'autre. Pour garder de la vitesse lorsque le vent mollit pendant quelques minutes et que notre voilure réduite ne suffit plus, en attendant le retour du vent qui ne tardera pas.
Durant les premières journées de ce type de navigation, j'ai accaparé la barre pendant des journées entières, jusqu'à ce que les conséquences de mon obstination sur ma fatigue en fin de journée nous poussent à réfléchir. En fin de journée, il reste l'arrivée parfois délicate et des manœuvres pointures et fatigantes à effectuer, ce n'est pas le moment que je m'effondre. Maintenant, nous partageons. Mais les raisons pour lesquelles je monopolisais ainsi le pilotage de Skol étaient multiples. Le plaisir d'abord, j'ai toujours adoré barrer et cette navigation procure des sensations multiples, changeantes, variées. Evoquons les plaisirs visuels. Je tire un bord en visant un glacier majestueux à demi voilé par les nuages bas. Le bord suivant se dirige, de l'autre côté, vers une vallée boisée profonde, somptueuse, encadrée de promontoires rocheux monumentaux. Au virement de bord suivant, un coin de ciel clair laisse passer pendant quelques minutes assez de soleil pour illuminer de bleu la coulée de glace qui dévale la pente dans une lenteur cosmique. Mais il y a aussi les plaisirs tactiles. Puisque le vent change constamment sa caresse fraiche sur le coin de joue et le bout du nez qui émergent des capuches et cols serrés, la main est sans cesse occupée à corriger le cap et le corps à sentir les mouvements, la gite et la vitesse du bateau qui s'altèrent à chaque instant. Ces heures interminables de barre furent pour moi un apprentissage. Branchée par tous mes sens au bateau et à l'environnement que je scrute en permanence, je tente de comprendre comment ça fonctionne. Sentir les évolutions de la température de l'air, anticiper en portant loin le regard pour détecter la trace sombre mouchetée de petits brisants que les rafales impriment à la surface de l'eau en se déplaçant, capter presque la texture de l'air, dont l'instabilité signe un temps à bourrasques tandis que sa constance permet d'espérer moins de surprises. Garder un œil sur les instruments de navigation pour évaluer le courant, la vitesse, et recalculer en permanence la route qui reste à faire (2) et la vitesse minimum nécessaire pour arriver avant la nuit. Plaisirs doux-amers. Apprentissage enthousiasmant et préoccupé.

Si Ariel n'était pas là, je serais bien plus souvent embourbée dans l'inquiétude de la suite que savourant le présent. Mais il me tire vers les plaisirs de la contemplation en s'exclamant à tout bout de champs sur la beauté des paysages et en partant dans de grandes déclarations d'amour adressées aux otaries qui viennent nous voir presque à chaque fois qu'on navigue. Mon homme, qui est par ailleurs aussi capable d'inquiétude que tout le monde, a semble-t-il une espèce d'indéboulonnable confiance dans le fait que nous nous adapterons à ce qui viendra et ne veut surtout pas laisser le souci de l'arrivée lui gâcher la journée. Jusqu'à présent, la réalité lui a donné raison. Nous nous adaptons merveilleusement à ces conditions difficiles. Il faut dire qu'on s'attendait à tant de difficultés, de mauvais temps, de conditions sauvages, de manœuvres chaotiques, que chaque situation un tout petit peu meilleure que le pire nous apparait comme une bonne nouvelle, voire une vraie chance, même si nous en sommes les architectes. Une légère atténuation de la pluie pendant l'appareillage nous réjouit. Une heure de soleil dans la journée est reçue avec ravissement. Le hasard d'un courant favorable à l'entrée du canal Barbara est imprévu mais bienvenu. Nous avons même eu quelques journées de navigation sans pluie du tout, rendez-vous compte ! Le froid ? On s'y attendait et on est bien équipés. On a tout de même eu une journée de vrai beau temps pendant laquelle on a quitté progressivement les couches de ciré, chapeau, polaire et même les bottes et chaussettes le temps d'une pédicure bienvenue et qui s'est achevée en pantalon normal et presque en bras de chemise. Une journée qui nous a absolument enchantés malgré l'absence quasi-totale de vent, pas question de bouder le plaisir d'un calme plat exceptionnel, il y aura assez de vent plus tard.
Paradoxalement, je n'ai aucun regret que nous n'ayons pas de capote pour nous protéger de la pluie. Tous les bateaux que nous avons vus en route vers le sud en ont une, plus ou moins vaste, plus ou moins couvrante mais personne d'autre que nous sans capote. Les guides nautiques recommandent même une couverture intégrale du cockpit par une toile façon caravane, montée sur une armature métallique. Mais nous n'étions pas convaincus. Je redoutais la prise au vent d'un tel dispositif, qui peut entraver les manœuvres, et Ariel ne se résignait pas à l'endommagement esthétique du bateau que cela entrainerait nécessairement. Et finalement, finalement, peut-être avions nous compris quelque chose de nos années de navigation tous temps. Peut-être avions nous l'intuition que notre façon de naviguer, très au contact des éléments, s'accommoderait bien de cette situation. En effet, notre poste de barre, à fleur de pont car le cockpit est peu profond est donc très exposé au vent mais cette propriété même s'avère à l'usage idéale pour la surveillance de tous les instants que nous considérons tous les deux comme indispensable dans ces eaux dangereuses. Ni le pilote électrique ni le régulateur d'allure ne peuvent barrer avec autant de finesse que nous et s'adapter à chaque instant et aucun des deux ne peut surtout an-ti-ci-per. Ils restent donc rangés.
Nous nous relayons donc à la barre et aux manœuvres de voile, les journées sont fatigantes mais pleines de sensations fortes et nous avons au fond de nous un peu de fierté (3) de faire battre les pavillons Harlé et Skol aux vents du sud aux cotés de nos voiles hissées. Fierté sitôt relativisée dès que nous songeons aux anciens, ceux qui exploraient ces rivages à la voile pure, avec des bateaux qui remontaient mal contre le vent. Comment faisaient-ils ? Certains passaient des semaines à attendre des vents favorables ou un peu moins contraires. D'autres épuisaient leurs équipages en les envoyant s'user les cals des mains aux avirons des doris pour remorquer le grand bateau… Autre époque, autres outils, autres hommes. Nous ne sommes pas assez tenaces et trempés à la vie rude pour nous comparer à eux.
-
Un bateau plus grand ou plus fin passerait mieux le clapot. Mais la petite taille de Skol a des avantages et sa largeur donne du volume à notre espace de vie. Chaque dessin de coque est un compromis entre des désirs parfois incompatibles.
-
La route qui reste à faire est vingt à soixante pourcent plus grande que la distance qui nous sépare de l'objectif, voire plus lorsque le vent et le courant se conjuguent contre nous, cas le plus fréquent tant que nous naviguons vers le nord-ouest, car les vents dominants (sud-ouest, ouest et nord-ouest) sont tous plus ou moins redirigés par les montagnes dans l'axe du détroit. A tel point qu'une journée de vingt-cinq milles de distance à parcourir peut se traduire par dix heures de navigation à quatre nœuds plein pot, soit quarante milles parcourus au total. Curieuse mathématique à laquelle nous nous résignons et qui explique en partie pourquoi nous progressons si lentement. Ça sera peut-être différent lorsqu'on aura pris le virage à droite et qu'on remontera les canaux de Patagonie vers le nord.
-
Aucun des rares voiliers que nous avons rencontrés dans le détroit de Magellan ne naviguait à la voile. Ni même voile et moteur. Le seul avec qui nous avons pu évoquer notre plaisir de faire de la voile et notre frustration de tant utiliser le moteur en soutien nous a semblé avoir complètement renoncé à la propulsion vélique, même secondaire. Trop de vents contraires, mon bateau ne remonte pas bien au vent, mon moteur ne supporterait pas la gîte…